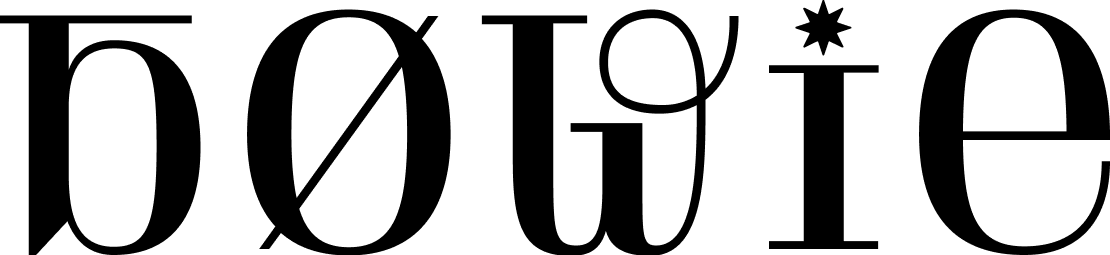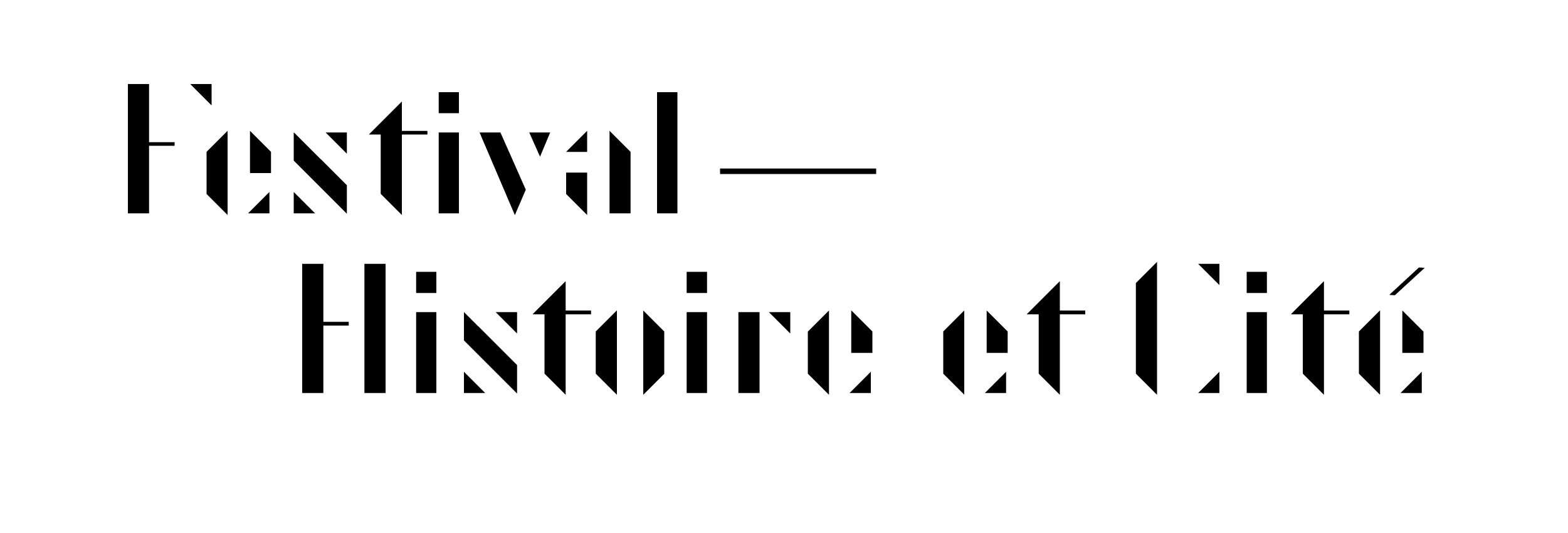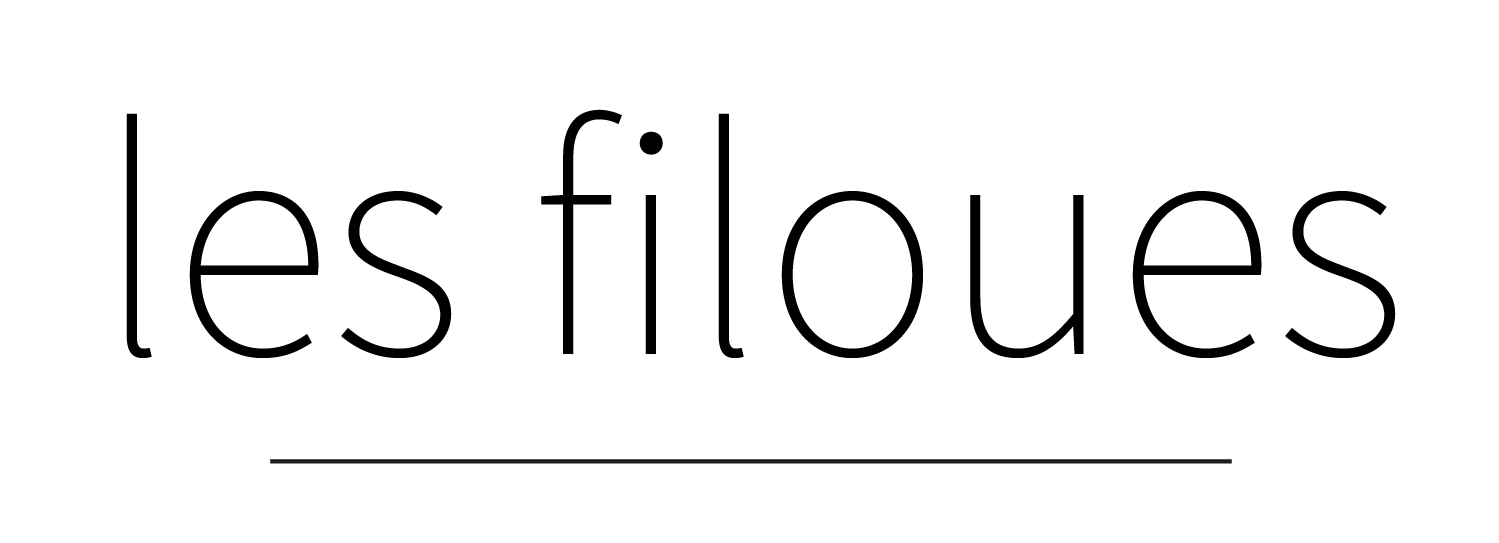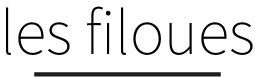Suzanne Favre, Anne Sechaye, Jeanne Blanc, …
Lire leur histoire
1782, le contexte politique est troublé. La population genevoise veut plus de droits, le pouvoir est, selon eux, trop concentré dans les mains de la haute société. Leur parti renverse le pouvoir en place, mais c’est une victoire de courte durée. Les armées française, sarde et bernoise interviennent pour restituer l’ordre.
Un nouveau projet de loi voit alors le jour : restreindre les droits des citoyens et renforcer la surveillance afin de prévenir de nouvelles insurrections. Cette surveillance accrue vise certains quartiers en particulier, notamment le très contestataire quartier de Saint-Gervais. Cette loi est sobrement intitulée « Édit de pacification ».
L’Édit de pacification est voté et approuvé le 21 novembre 1782 par le Conseil général qui rassemble tant l’oligarchie que le reste des citoyens de la ville. En sont bien entendu exclus les étrangers et les femmes, ainsi que les natifs descendants des étrangers nés à Genève. Et dans ce contexte difficile, le gouvernement met toutes les chances de son côté en interdisant aux contestataires notoires de prendre part au vote et en faisant lourdement pression sur les votants.
Comme cela était coutumier à cette période, le vote est suivi d’un appel général à se rendre aux temples de la ville afin de prier collectivement dans un geste de réconciliation. La population des différents quartiers ne se plie pas à l’appel de manière homogène. La Cathédrale Saint Pierre est pleine, le temple de la Madeleine nettement moins et le temple de Saint-Gervais est très peu fréquenté signe du manque d’adhésion de la population du quartier à l’Édit.
Dire « manque d’adhésion » est un euphémisme. Une véritable colère secoue Saint-Gervais. Les femmes, souvent accompagnées de leurs enfants, prennent la rue pour crier leur révolte face à cette loi injuste. Alors qu’elles ne peuvent pas prétendre au droit de vote, elles s’insurgent de sa réduction. Alors que l’imaginaire collectif les cantonne au domaine de l’intérieur, ces femmes sont dehors, ces femmes sont bruyantes, ces femmes ont des opinions politiques. Ces femmes sont furieuses.
C’est l’émeute, une foule de femmes et d’enfants s’amasse autour du temple afin de prendre à parti ceux qui s’y rendent sagement, les membres du parti au pouvoir ou les citoyens du quartier ayant accepté de signer l’Édit. Elles ne se contentent pas d’invectiver les votants, elles se font entendre en recouvrant bruyamment le prêche.
Cris, moqueries, jets de pierres, huées, bancs retournés, insultes et bruits assourdissants faits avec des sabots, les femmes accompagnées de leurs enfants se font entendre. C’est le vacarme. Les insultes redoublent à la sortie. Le responsable administratif du temple s’emporte et est aperçu poursuivant des enfants son épée à la main. Sans succès. Ces femmes sont dehors, ces femmes sont bruyantes, ces femmes ont des opinions politiques. Ces femmes sont furieuses.
Plusieurs personnes visées par la foule témoignent : « la fille […] qui était près de moi [dit] en me regardant “on a bien mis des espions dans les coins de nos maison on ne s’en embarrasse pas plus que de ceux qui les y ont mis“, alors je demandai son nom […] & la fille […] me dit alors “qu’est-ce que cela vous fait de savoir mon nom ?“, je lui répondis que je voulais me plaindre de ses insultes & elle me répondit “à qui ? à ces beaux magistrats de merde ?“ ». Le ton est donné.
Les témoignages ne permettent de connaître l’identité que d’une poignée de ces émeutières, celles qu’on décrit comme les plus virulentes, Suzanne Favre, 27 ans, polisseuse, Anne Sara Sechaye, 38 ans, doreuse et Jeanne Blanc, 68 ans, porteuse d’eau, notamment. Elles sont interrogées par les magistrats et nient toutes avoir participé à l’émeute. Aux cris. Au vacarme.
Il faut imaginer cette clameur. On parle d’ « invisibles » mais l’oppression des femmes à travers l’histoire passe par plusieurs sens, pas seulement la vision. Le toucher – le manque de droit à disposer de son corps par exemple, ou encore l’ouïe, le contrôle du discours, la réduction au silence. Il faut imaginer cette clameur à Saint-Gervais, ce 21 novembre 1782, quand ces femmes remplissent tout l’espace de leurs cris, quand le temps d’un instant elles font tout ce qu’on n’attend pas d’elles : du bruit. Un bruit que moi, une femme d’aujourd’hui, en 2022, 240 ans après ces émeutières, j’entends encore résonner à mes oreilles et dans mon ventre.
Ces femmes sont dehors, ces femmes sont bruyantes, ces femmes ont des opinions politiques. Ces femmes sont furieuses.
Pour en savoir plus...
En 1782, Genève est pertubée par des événements révolutionnaires. Après plusieurs décennies de hautes tensions politiques, le parti des «Représentants», qui exige plus de droits politiques, renverse l’oligarchie et prend les rênes du pouvoir. La courte révolution est bientôt interrompue par l’intervention des armées françaises, sardes et bernoises qui imposent un édit de pacification limitant les droits de la bourgeoisie. Pour favoriser la concorde à la suite de la ratification de l’Edit, les autorités appellent – au son de cloche – toute la population à se rassembler dans les différents temples de la ville pour la prière.
Bibliothèque de Genève, Ami Dunant, Copie du journal des événements de 1782 à 1793, t. I, Ms. 908, p. 18 : A une heure ½ la clémence et toutes les cloches sonnèrent jusqu’à deux heures […] Le conseil se rendit en corps à Saint Pierre, l’Eglise était très pleines, à la Madelaine il y eu peu de monde et très peu à Saint Gervais, ou il y eut même un scandale, un nombre de femmes & d’enfants se tenaient aux portes de l’Eglise, jetaient des pierres contre, faisaient du bruit afin qu’on n’entendît pas la prière, se moquaient de ceux qui allaient, Messieurs les syndics informés ordonnèrent à Monsieur l’Auditeur Grenus de faire une procédure qui ne fit connaître aucun coupable.
En novembre 1782, un attroupement de femmes et d’enfants autour du temple de Saint-Gervais vise à stigmatiser les signataires de l’édit controversé et les participant.e.s au culte par des cris, insultes et jets de pierre.
Archive d’Etat de Genève, Procès Criminel, 1ère série, 13988, novembre 1782, Déposition de Louise Jeanneret : J’étais hier chez moi à la rue du temple de Saint Gervais entre deux et trois heures [j’entendis du] bruit, jet de pierre, contre les porte du temple, je descendis la rue à Massis sur un banc vis à vis du temple je fus fâchée d’être venue & n’osai plus me retirer de peur d’être insultée par la foule qui était là au temple, & pendant que j’étais là la fille Pitard qui était près de moi [dit] en me regardant on a bien mis des espions dans les coins de nos maison on ne s’en embarrasse pas plus que de ceux qui les y ont mis, alors je demandai son nom à une femme qui était près de moi que je connais pas & la fille Pitard me dit alors qu’est-ce que cela vous fait de savoir mon nom, je lui répondis que je voulais me plaindre de ses insultes & elle me répondit à qui à ces beaux magistrats de merde & autres mots injurieux que je n’ai pu retenir.
Les magistrats qualifient l’émeute de «désordre scandaleux», en écartant l’aspect politique du tapage. La dépolitisation de la violence des émeutières passe également par leur déresponsabilisation: les membres du Petit Conseil insistent ainsi sur le mauvais encadrement du marguillier qui aurait «donné lieu à quelques personnes de commettre ce désordre». Comme souvent, les émeutières se trouvent frappées «d’anonymisation» (Regina 2017): un pasteur hostile qualifie le groupe émeutier de «populace», terme qui désigne péjorativement le «bas-peuple». Les enfants mâles, futurs citoyens de la République, sont par ailleurs immédiatement saisis par la justice pour être détenus en prison, tandis que les femmes seront entendues, puis censurées, à la fin de la procédure.
Depuis la fin des années 1980, les «évidentes émeutières» d’Ancien Régime ont été réhabilitées dans leur fonction clé d’agentes de violences dans l’espace public, notamment en tant que mobilisatrices et boute-feux (Farge 1991). Si l’historiographie a souvent réduit les émeutières à leur rôle de garantes morales et domestiques dont la participation se limiterait aux émeutes de subsistance, leur fonction complexe dans les révoltes politiques est mieux connue aujourd’hui (Chevalier 2012). Néanmoins, il reste de nombreux champs d’action à élucider en ce qui concerne les violences féminines, encore marquées par les difficultés méthodologiques posées par les sources.
Eléonore Beck, Clarissa Yang, « Furieuses. A la recherche des transgressions oubliées », Revue du Ciné-club universitaire, mars 2022, p. 107-113.
Voir les oeuvres originales
Toutes les oeuvres originales de ce projet sont exposées à la BØWIE Gallery du 14 mars au 3 avril 2022.
Adresse :
Confédération Centre
1er étage
Rue de la Confédération 8
CH-1204 Geneva
Horaires :
Lundi : 9:30-19:00
Mardi : 9:30-19:00
Mercredi : 9:30-19:00
Jeudi: 9:30-20:00
Vendredi: 9:30-19:30
Samedi: 9:30-18:00
Dimanche: Fermé
Accéder au site web de la BØWIE Gallery