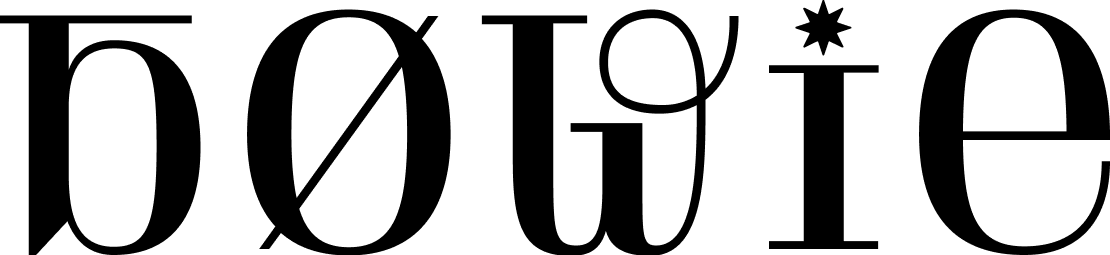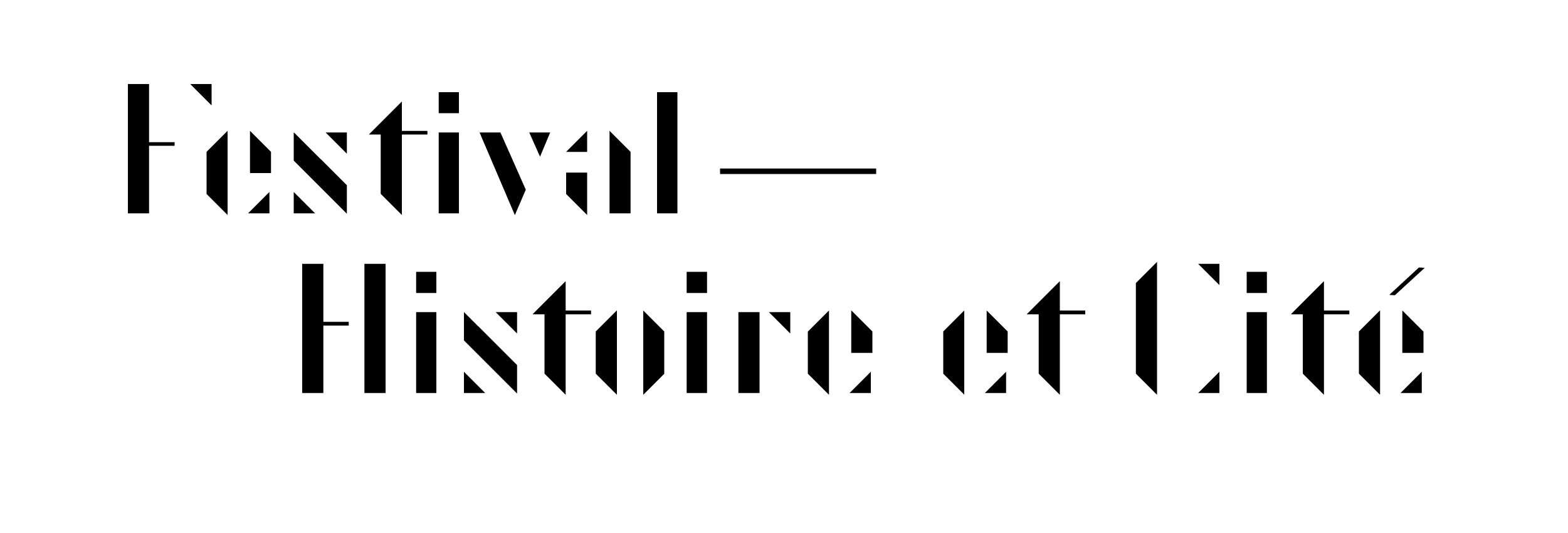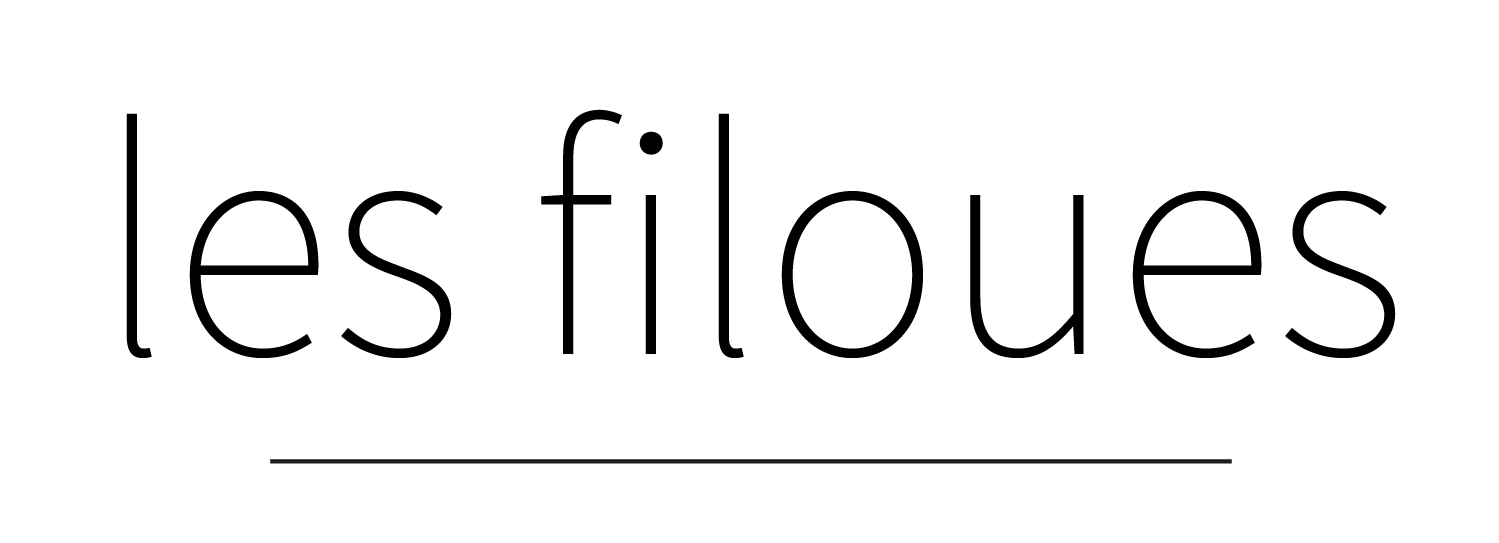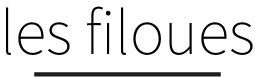Furieuses
Catherine et Gabrielle Paillard
Lire leur histoire
Elles sont sœurs. Les sœurs Paillard.
L’aînée, Catherine, est veuve. Elle a 29 ans, vit pauvrement comme raccommodeuse de bas et a déjà été condamnée pour paillardise à plusieurs reprises. Avec un nom pareil, c’est presque une destinée. Elle est celle dont on dit qu’elle a mauvais caractère, la cause perdue du duo.
La cadette, Gabrielle, a 23 ans. Elle est plus sage ou moins mémorable c’est selon. D’elle on dit qu’elle se repentit, sous-entendu qu’elle peut être sauvée.
Elles partagent un appartement au quatrième étage qui donne sur la place de Saint-Gervais. C’est dans l’appartement que tout se passe. Personne ne témoigne de l’intérieur, personne n’admet ça. C’est de l’extérieur que viennent les plaintes. Du voisinage et du pasteur de quartier. Une enquête est lancée en février 1783.
Elles sont accusées de prostitution et le grand facteur aggravant c’est que ça se voit. L’extérieur n’aime pas l’exposition de l’intérieur.
C’est la fenêtre par laquelle elles appellent les soldats qui concentre le ressentiment général. La fenêtre. Cette membrane transparente entre l’en-dedans et l’au-dehors qui cristallise tous les possibles, tous les fantasmes d’évasion et de voyeurisme, mais qui ne dois jamais, jamais, s’ouvrir car alors la supercherie de la séparation entre le privé et le public serait exposée.
Les sœurs Paillard ouvrent la fenêtre en grand. Elles y glissent leurs corps et aguichent leurs clients potentiels en bas. Furieusement effrontées les sœurs Paillard. Elles s’en foutent de briser la barrière invisible de la bienséance, de transgresser l’au-dehors avec leur pratique.
Celles qui abandonnent la honte derrière elles font trembler le réel.
Il faut dire qu’elles ont déjà une réputation. Elles ont été renvoyées des quartiers de Rive et de Cornavin à cause de leur « mauvais train de vie ». En plus de la foule d’hommes qui se rendent à l’appartement et des filles « de leur trempe » que les sœurs hébergent, les voisins craignent le feu en évoquant une bassine ardente qui se trouverait trop près d’un lit. Ils craignent aussi pour leurs possessions. Un armurier du quartier qui se serait rendu à l’appartement se serait fait voler sa montre d’argent après avoir bénéficié de leurs services.
Les registres indiquent : « Les voisins arrêtèrent que ces gens-là poussent l’effronterie jusqu’à appeler souvent de leurs fenêtres les soldats quelles voient passer dans la rue ; non seulement ces visites scandaleuses font de leur maison un lieu infâme de prostitution mais les voisins se regardent comme continuellement exposés et fonder a craindre pour la sureté de leurs personnes et de leurs biens elle ne se contentent pas d’attirer chez elles des gens inconnus et sans aveu elles logent dans leur appartement pour des termes plus ou moins courts des filles de leur trempe que l’on voit continuellement se succéder et se renouveler ; En un mot leur voisinage est pour les honnêtes gens le plus affligeant des scandales un sujet continuel de craintes et d’alarmes à divers égards, une perte pour les jeunes gens, un mal auquel ni les exhortations ni les censures ne sauroient apporter aucun remède et qui ne peut être absolument détruit que par l’autorité du Gouvernement ».
L’enquête du Consistoire, tribunal ecclésiastique gérant principalement les mœurs, conclut donc qu’il faut absolument transmettre l’affaire au Petit Conseil qui juge les affaires criminelles.
Tout au long de la procédure judiciaire, les deux sœurs nient toutes les accusations retenues contre elles : le vol de la montre comme la prostitution ou le maquerellage. La procédure rassemble des témoignages mais aussi beaucoup de rumeurs entendues et qui ont pour effet de marginaliser les deux sœurs au sein de leur quartier, jusqu’à recevoir insultes et mépris.
C’est face au magistrat que les sœurs Paillard se différencient l’une de l’autre. Gabrielle, soucieuse de sa réputation, se montre soumise et repentante. Catherine, elle, campe une posture vindicative et effrontée. Les témoignages vont dans ce sens soulignant « la plus grande indignation » face aux actions et à la violence de Catherine alors qu’on ne reproche à Gabrielle que sa débauche mais on ne se plaint pas de son caractère.
Gabrielle se repend devant Dieu et la Seigneurie à la fin de son interrogatoire. Catherine dit seulement « Je n’ai rien à répondre ». Parfois le silence est la plus terrible des révoltes.
Le 7 mars 1783 le Petit Conseil rend son verdict et punit Catherine plus durement que Gabrielle.
Ce sera un mois de prison et des excuses à présenter, pour la première, avec la menace que si elle est à nouveau le sujet de plaintes elle sera expulsée de la ville irrémédiablement. La cadette est, elle, condamnée à huit jours de prison.
J’essaie de tendre le bras pour effleurer ces sœurs par-delà le temps. A la lecture de cette procédure je n’entrevois pas d’empathie pour les conditions de pauvreté et de rejet social auxquelles les sœurs Paillard font face, s’il y en a eu, elle ne s’entend pas entre les mots qui restent. Je me demande ce qui se passe en soi quand on est une « cause perdue ». Quand plus personne ne croit qu’on puisse exister en-dedans du monde. Quand on est regardée comme indécente, moralement inepte, honteuse. Peut-être qu’on est révoltée, qu’on trouve qu’on n’a jamais eu sa chance dans son contexte familial et sociétal. Peut-être qu’on est désespérée, que le futur incertain vacille sous nos pieds, peut-être qu’on a peur. Ou peut-être qu’on s’en fout. Peut-être qu’on est déjà trop loin de ce monde qui n’a pas su nous accueillir. Peut-être qu’on a plus honte d’avoir eu trop honte. Peut-être qu’on est furieuse.
Pour en savoir plus...
L’invisibilité caractérise les cas de maquerellage et de prostitution, à l’image des sœurs Catherine et Gabrielle Paillard. Leurs activités ne sont portées devant les autorités judiciaires qu’en dernier recours, notamment lorsque l’équilibre fragile entre visibilité sociale et moralité publique a trop fortement été rompu aux yeux des voisins et du pasteur de quartier (Gonzalez-Quijano, Roby 2017). Criminalisée sous l’Ancien Régime, la prostitution s’insère dans le territoire de «l’antimonde» (Brunet 1992): l’enquête de voisinage menée par le Consistoire fait ainsi état d’une longue période où les deux femmes exercent clandestinement sans que les autorités en soient informées. Estimant que «[ni] les exhortations ni les censures ne sauraient apporter aucun remède», les pasteurs transmettent l’affaire à «l’autorité du Gouvernement», qui condamne les deux sœurs à la prison en chambre close.
En 1783, les sœurs Paillard auraient tenu un «lieu infâme de prostitution» dans leur appartement du quatrième étage qui donne sur la place de Saint-Gervais. Le scandale public tient principalement à la visibilité de l’activité illicite qui s’y tient. Interpellant les soldats depuis leur fenêtre, les deux sœurs logent dans leur appartement des «filles de leur trempe» et reçoivent «une foule de gens» «à toute heure du jour et de la nuit».
Dès 1782, les autorités genevoises doivent faire face à une explosion de la prostitution qui s’instille dans des caves, des rues ou des appartements privés. Dynamique, l’espace domestique comporte de multiples usages, que les femmes savent parfaitement exploiter (Vickery 2007). Les prostituées et maquerelles jouent de cette frontière ténue entre visible et invisible, espaces privé et public, afin d’échapper au regard de la justice, tout en restant apparentes aux yeux de leur client.
Archives d’Etat de Genève, Registre du Consistoire R. 91, « Catherine Paillard, Femme Girome & Gabrielle Paillard », 13 février 1783, fol. 331 : En un mot leur voisinage est pour les honnêtes gens le plus affligeant des scandales un sujet continuel de craintes et d’alarmes à divers égards, une perte pour les jeunes gens, un mal auquel ni les exhortations ni les censures ne sauroient apporter aucun remède et qui ne peut être absolument détruit que par l’authorité du Gouvernement.
Dans la procédure judiciaire menée par le Petit Conseil, le contenu des témoignages fait état de la réputation scandaleuse qui s’est forgée autour de ces deux femmes depuis leur entrée dans le quartier. La plupart des témoins soulignent avoir «ouï dire» ou «entendu tenir» beaucoup de propos sur leur compte», notamment que «c’était des catins». Certains ont pu observer de plus près leur «vie scandaleuse», notamment «le mauvais train» qu’elles menaient chez elle.
Le comportement des deux sœurs est perçu dans un jeu de miroir par le magistrat et les témoins. Tandis que l’aînée, la veuve Catherine, est jugée par le voisinage comme vindicative et effrontée, la jeune Gabrielle jouit quant à elle d’une réputation moins sulfureuse. Le témoin Jean-Jacques Pittard, horloger de 56 ans, indique avoir des plaintes à former « moins contre la cadette que contre l’ainée », indiquant que « la femme Gérome avait toujours des sottises à la bouche contre tout le monde & menait une vie plus scandaleuse que sa sœur ».
Voir Archives d’État de Genève, Procès Criminel, 1ère série, 14038 bis, février-mars 1783.
Eléonore Beck, Clarissa Yang, « Furieuses. A la recherche des transgressions oubliées », Revue du Ciné-club universitaire, mars 2022, p. 107-113.
Voir les oeuvres originales
Toutes les oeuvres originales de ce projet sont exposées à la BØWIE Gallery du 14 mars au 3 avril 2022.
Adresse :
Confédération Centre
1er étage
Rue de la Confédération 8
CH-1204 Geneva
Horaires :
Lundi : 9:30-19:00
Mardi : 9:30-19:00
Mercredi : 9:30-19:00
Jeudi: 9:30-20:00
Vendredi: 9:30-19:30
Samedi: 9:30-18:00
Dimanche: Fermé
Accéder au site web de la BØWIE Gallery